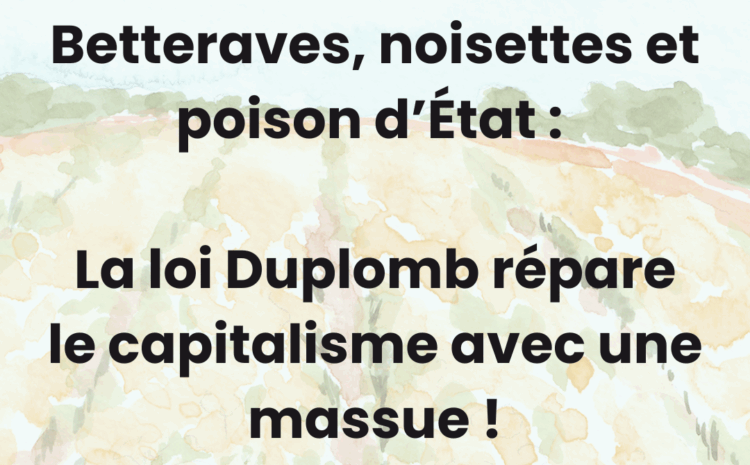
La loi Duplomb (officiellement « loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ») est une réforme agricole votée définitivement par l’Assemblée nationale le 8 juillet 2025.
Sous prétexte de « modernisation », on allège les procédures (pour les entreprises), on « simplifie » les normes (comprendre : on les jette), et on « fluidifie » le marché du travail (traduction : précarité pour tout le monde, sauf le CAC 40). En gros, la loi Duplomb, c’est un peu comme repeindre une centrale nucléaire avec du vernis à ongles : ça brille, ça pue, et ça explose toujours.
Bref, un monde merveilleux où :
– les contrôles deviennent un vilain mot,
– le droit du travail est une contrainte dépassée,
– et la planète ? Elle n’avait qu’à pas être aussi inflammable.
Merci à la loi Duplomb de rappeler une fois de plus que le rôle que ce gouvernement assigne à l’État, ce n’est pas de protéger les citoyens, mais d’assurer la rentabilité des actionnaires. Pendant ce temps-là, les salariéEs galèrent, les services publics clamsent, les vieux et vieilles, les malades, les handicapéEs et tous ceux et celles qui sont considéréEs comme improductifs crèvent tandis que la planète surchauffe – mais hé, au moins les tableaux Excel sont contents.
Regardons-y d’un peu plus près.
D’abord le calendrier législatif : proposition déposée au Sénat le 1er novembre 2024 par Laurent Duplomb (LR) et Franck Menonville (UDI), avec soutien du gouvernement Bayrou. Adoptée par le Sénat fin juin 2025, puis en Commission Mixte Paritaire avec soutien du gouvernement Bayrou (30 juin), définitivement votée le 8 juillet 2025 avec 316 voix pour et 223 contre. Le 11 juillet, plus de 60 députéEs, suiviEs le 18 juillet par plus de 60 sénateurices, saisissent le Conseil constitutionnel pour « irrégularité de la procédure et refus de principes à valeurs constitutionnelles comme le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, le devoir de préservation de l’environnement, les principes de prévention, de précaution, de participation du public aux décisions environnementales, ainsi que le principe de non-régression ».
En outre, le 10 juillet, Eléonore Patterny, étudiante de 23 ans en santé environnementale a déposé une pétition sur le site de l’Assemblée nationale. En l’espace de 48h, cette pétition a reçu 300 000 signatures ; elle a aujourd’hui dépassé le million de signatures (1 315 072 à l’heure de la rédaction de cet article) : du jamais vu. Cette pétition va obliger à un nouveau débat au cœur de l’Assemblée, sans que celle-ci ne dispose de pouvoir de révocation de la loi ; pour autant, cette pétition met au jour une révolte démocratique qui donne de l’espoir en ces temps morbides.
La proposition a divisé la majorité gouvernementale : le groupe macroniste Ensemble pour la République a voté aux deux tiers pour (14 contre, 10 abstentions). Neuf députés MoDem et trois Horizons ont voté contre.
Sous prétexte de simplification administrative et de soutien au monde agricole, la loi Duplomb constitue une régression brutale en matière de protection de l’environnement, de santé publique, et de démocratie locale. Pour l’écologie sociale, cette loi est l’expression d’un modèle agricole productiviste à bout de souffle, qui sacrifie le vivant pour sauver les marges à court terme.
Un chèque en blanc aux lobbies phytosanitaires, à l’industrie agricole et aux tenants du modèle extractiviste
Le retour autorisé des néonicotinoïdes, ces insecticides neurotoxiques connus pour leurs effets dévastateurs sur les pollinisateurs, constitue un recul écologique et social majeur. Présentée comme « encadrée », cette réintroduction vise avant tout à rassurer certaines filières agro-industrielles (notamment betteravières), au mépris des alertes scientifiques et du principe de précaution.
Pire encore : l’ANSES, l’agence indépendante de sécurité sanitaire (et pas vraiment révolutionnaire) qui jusqu’à présent réalisait sa mission d’évaluation des risques sanitaires dans les domaines de l’alimentation, de l’environnement et du travail en toute indépendance, se voit désormais tenue de respecter un calendrier dicté par le ministère de l’Agriculture. Cette mise sous tutelle mine donc son autonomie et sa capacité d’agir dans l’intérêt général quant à l’autorisation, au refus ou au retrait de certains pesticides du marché.
L’eau privatisée pour l’agro-industrie
Autre pilier inquiétant de la loi : la construction des mégabassines est désormais considérée comme relevant de la reconnaissance de la « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM). Cette qualification juridique permet de court-circuiter les procédures environnementales et même d’exproprier des terres au profit de projets d’irrigation massifs. Elle fait d’ailleurs l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel depuis le 11 juillet par 60 députés de gauche.
Ces réservoirs géants, financés en partie par l’argent public, bénéficient à une minorité d’agriculteurs aux modes de production intensifs, souvent les plus connectés aux coopératives agroalimentaires et fonctionnant selon le modèle industriel. Pendant ce temps, les nappes phréatiques s’épuisent, les sécheresses s’aggravent, et les agriculteurs en transition agroécologique peinent à accéder à l’eau.
L’élevage industriel renforcé
La loi relève les seuils à partir desquels les élevages doivent faire l’objet d’une étude d’impact environnemental. En clair, des exploitations de plus de 80 000 volailles ou 3 000 porcs pourront se développer sans véritable contrôle, ni débat public.
Ce choix favorise les fermes-usines au détriment des petits élevages liés à l’agriculture paysanne, des riverains, de la santé des animaux et des travailleurs et travailleuses agricoles de ces élevages qui assistent et participent à cette souffrance sans possibilités de recours.
Non-seulement cela accentue l’industrialisation de la production de viande en réifiant ces animaux, les réduisant en « chose à manger », mais concentre aussi la plus-value du travail agricole (êtres humains et non-humains) tout en entretenant la vision d’une nature comme « ressource gratuite » par l’externalisation des coûts à travers le rejet de polluants dans les sols et cours d’eau. Ces dégâts sont du reste financés à grands renforts de subventions publiques (européennes et nationales), et ce à hauteur de 10 Milliards d’euros.
En parallèle de cette politique qui va augmenter le nombre de personnes souffrant de maladies chroniques, le gouvernement n’hésite pas à demander aux malades de « faire des efforts » et de se responsabiliser. Ainsi, la loi de financement de la Sécurité sociale, prévoit de réduire l’accès aux soins, notamment en limitant l’accès à la reconnaissance d’Affections de longue durée (ALD) qui concernent les malades chroniques dont font partie les victimes de l’industrie agroalimentaire. Pourtant le collectif Cancer Colère nous rappelle avec insistance que les liens entre cette industrie agro-alimentaire basée sur la chimie et l’augmentation des cancers sont aujourd’hui largement documentés. Cerise sur le gâteau, alors que les personnes malades et handicapées se voient refuser le droit à des conditions de vie dignes et l’accès aux soins, le gouvernement (ainsi que des parlementaires de gauche comme de droite) a voté en première lecture une loi donnant droit à une aide à mourir. Les victimes de maladies environnementales se verront donc contraint à un dilemme cornélien : crever en silence ou se faire acteur de leur propre mort.
Pour une agriculture paysanne
L’écologie sociale ne nie pas les difficultés du monde agricole : effondrement des revenus, précarité, surendettement, explosion du taux de suicide. Mais la solution ne réside pas dans l’allégement des normes sanitaires ou environnementales, ni dans la fuite en avant agro-chimique. Elle passe par la reconnaissance de l’agriculture, de l’eau ainsi que des systèmes alimentaires en tant que Communs : ce sont des ressources qui n’ont rien à voir avec le CAC40, rien à voir avec la financiarisation capitaliste. L’écologie sociale soutient par la mise en sécurité sociale[1] :
- L’agroécologie et l’agriculture paysanne ;
- L’accès à l’eau et son partage démocratique et à l’échelle des territoires de vie ;
- Le renforcement des protections environnementales, notamment par la mise en visibilité des interdépendances des êtres humains et non-humains ;
- La démocratie directe, pour décider des besoins de subsistance en privilégiant la relocalisation des filières alimentaires et la co-existence des systèmes alimentaires.
La loi Duplomb tourne le dos à ces perspectives. Elle verrouille un système agricole inégalitaire, destructeur du vivant, et de plus en plus coupé de la société. Cette loi Duplomb est encore un acte révélant une France démocratiquement défigurée où règne le totalitarisme inversé : réformes imposées malgré leur rejet massif comme pour les retraites, loi immigration, loi travail, état d’urgence permanent, usage de la police pour briser la contestation, main-mise des grandes fortunes et des lobbies sur les médias, les partis, les politiques publiques, abstention record dans toutes les élections notamment professionnelles, effondrement du débat public, montée de l’extrême droite comme dérivatif, etc.
Dans cette configuration la démocratie n’est plus un projet populaire. Elle est managée, technocratique, verrouillée. La démocratie, ce n’est pas le marché avec un droit de vote instrumentalisé par des médias au service des plus puissants et de l’extrême droite.
C’est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple.
Vive La Sociale !
[1] Voir notre brochure La Sécurité sociale de l’alimentation à l’aune du communalisme.